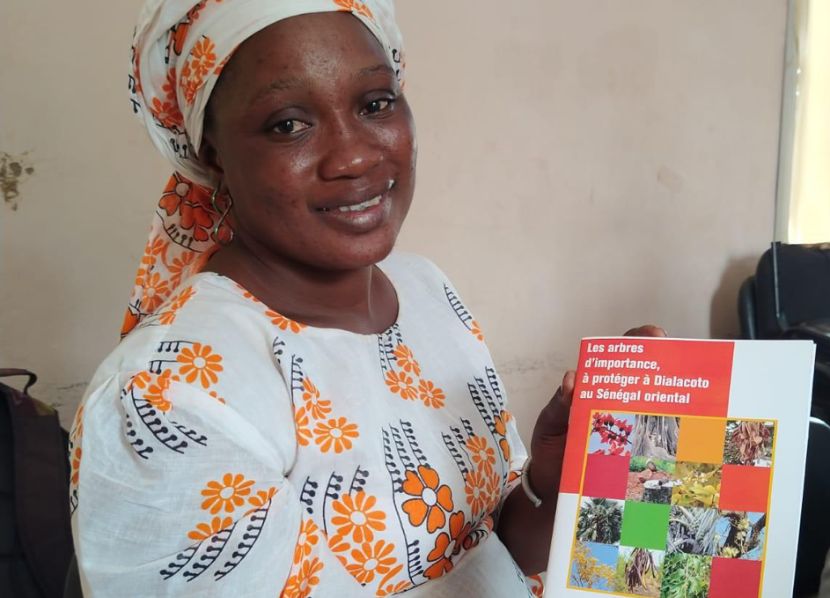Depuis plus d’une décennie, le Mali traverse une crise sécuritaire. Cette instabilité a bouleversé la vie de centaines de milliers de civils. Beaucoup ont été contraints d’abandonner leurs foyers, fuyant la violence pour se réfugier dans des localités censées être plus sûres, comme les villes de Mopti, Tombouctou, et leurs environs.
Ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes vivent en situation de déplacement forcé dans le pays. À Mopti et à Tambouctou, plusieurs dizaines de milliers déplacés ont été recensés, dont la moitié sont des femmes. Derrière ces chiffres, se cachent des réalités humaines douloureuses : familles éclatées, pertes de moyens de subsistance, isolement, dépendance et vulnérabilité accrue.
Des communautés d’accueil déjà sous pression
Les localités qui reçoivent les familles déplacées sont souvent elles-mêmes confrontées à d’importants défis. Leurs infrastructures sont fragiles, leur économie essentiellement informelle, et leurs ressources naturelles affectées par les sécheresses récurrentes, la pauvreté et le manque d’accès aux services de base. L’arrivée de dizaines de milliers de personnes supplémentaires aggrave ces difficultés. Toutefois, malgré cette pression, les communautés hôtes accueillent les nouveaux arrivants avec une grande dignité et un sens profond de la solidarité.
L’implication des résidents et responsables locaux
À travers le pays, des responsables municipaux, des associations villageoises, des groupements de femmes, des chefs coutumiers et des jeunes se mobilisent pour apporter des solutions pragmatiques à l’intégration des personnes déplacées. À Dongo, Farimaké, Hamzakoma et Séréré, ces acteurs locaux ont été les premiers à alerter sur les besoins. Soutenus par les partenaires maliens de SOS SAHEL, ils ont contribué à organiser des consultations, recenser les familles, et adapter des espaces communs pour accueillir les nouveaux arrivants.
Ce travail de proximité est fondamental : il permet une meilleure connaissance des réalités locales, une médiation culturelle plus fluide, et surtout une implication réelle des personnes concernées dans les décisions et la mise en œuvre des actions.
Des réponses économiques structurantes
L’une des priorités identifiées par les communautés a été de redonner aux familles déplacées la possibilité de subvenir à leurs besoins. Ainsi, plusieurs projets d’activités économiques ont vu le jour. À Dongo, une fromagerie a permis à 35 femmes déplacées de transformer le lait local en fromage. Elles y travaillent collectivement, organisées en coopérative, et génèrent un revenu régulier qu’elles investissent dans les besoins de leur foyer.
À Hamzakoma, des producteurs locaux ont bénéficié de l’installation d’une unité d’étuvage du riz. Cette technologie leur permet non seulement d’améliorer la conservation et la qualité de leur récolte, mais aussi d’en tirer un meilleur prix sur les marchés locaux. La localité de Farimaké, de son côté, a développé une unité de séchage de viande. En transformant les produits de l’élevage, les habitants valorisent un savoir-faire ancien et créent des débouchés supplémentaires. À Séréré, c’est la pisciculture qui s’est imposée comme une alternative durable : un bassin a été aménagé pour l’élevage de poissons destinés à la consommation locale.
Chaque activité économique a été pensée en fonction du contexte local, des ressources disponibles, et des savoirs déjà présents dans la communauté. Ce lien entre innovation et tradition est un facteur de réussite essentiel.

L’agriculture et l’élevage au service de l’autonomie
En complément de ces unités de transformation, un vaste programme d’appui à l’agriculture et à l’élevage a été lancé. Plus de 1 200 petits ruminants — chèvres et moutons — ont été distribués à des familles déplacées. L’objectif n’est pas seulement alimentaire : il s’agit de reconstituer un capital de départ, de créer un patrimoine reproductible, et de renforcer la sécurité économique des foyers.
Parallèlement, deux hectares de terres cultivables ont été aménagés dans chaque commune, équipés de systèmes d’irrigation adaptés. Ces espaces ont été confiés à 170 personnes, majoritairement des femmes, organisées en groupements. Elles y cultivent des légumes destinés à la consommation familiale, mais aussi à la vente sur les marchés locaux. En favorisant les circuits courts, ces exploitations renforcent l’économie de proximité et permettent aux femmes de reprendre leur place dans le tissu économique.

Bâtir la confiance pour reconstruire la vie en société
Mais reconstruire une vie ne se limite pas à retrouver un emploi ou un champ à cultiver. Il faut aussi (et surtout) trouver sa place dans une communauté, se sentir écouté, respecté, et capable de contribuer à la vie collective. C’est pourquoi un dispositif d’accompagnement social a été mis en place dans les quatre communes. Il ne s’agit pas seulement de réunions formelles, mais d’espaces de parole, de rencontres culturelles, de moments partagés autour de repas, de chants ou de contes. Ce sont dans ces instants que se retissent les liens.
Ces échanges entre déplacés et résidents permettent d’aborder les tensions, les incompréhensions, mais aussi de partager des pratiques agricoles, des recettes, des habitudes de soin. Cela crée une nouvelle culture commune, un sentiment d’appartenance élargi, où chacun retrouve dignité et reconnaissance.
Demba Konta, élu à Youwarou, l’exprime simplement : « Il n’y a pas d’intégration sans dialogue. Et il n’y a pas de dialogue sans confiance. »
Des résultats visibles, des trajectoires transformées
Les impacts de ces actions se mesurent autant en chiffres qu’en récits de vie. Mariame Sacko, présidente du groupement des maraîchères à Séréré, explique : « Avant, nous cultivions seulement pour survivre. Aujourd’hui, nous avons des outils, des semences de qualité, et surtout des débouchés. Nos enfants retournent à l’école. Nos repas sont plus variés. Et nous avons retrouvé notre fierté. »
De son côté, Safi Wallet Mossa témoigne des bénéfices de l’étuvage du riz : « Maintenant que nous transformons notre riz sur place, nous ne sommes plus à la merci des acheteurs extérieurs. Nous fixons nos prix. Nous avons du pouvoir. »
Des défis encore nombreux
Néanmoins, ces succès ne doivent pas masquer les difficultés persistantes. L’insécurité reste présente dans certaines zones, freinant l’accès régulier aux marchés et aux champs. Les aléas climatiques, de plus en plus fréquents, compliquent les récoltes. Enfin, le besoin en financement est constant, car de nombreuses familles restent encore exclues des programmes.
Une démarche qui inspire au-delà du Mali
En conjuguant ancrage local et approche inclusive, les communes de Dongo, Farimaké, Hamzakoma et Séréré démontrent qu’une réinsertion réussie est possible, même dans un contexte de grande fragilité. Leur expérience intéresse aujourd’hui d’autres collectivités au Sahel, mais aussi des organisations régionales.
Pour les acteurs, la clef réside dans l’écoute des premiers concernés, la valorisation des savoirs locaux, et l’accompagnement dans la durée. Car ce sont les déplacés eux-mêmes, aux côtés des communautés hôtes, qui inventent chaque jour des manières de vivre ensemble, de travailler ensemble, et de rebâtir l’avenir.

Une solidarité enracinée
Le chemin de la réinsertion est long, semé d’obstacles, mais il est aussi porteur d’espoir. Partout où les familles déplacées sont accueillies, accompagnées et valorisées, les résultats sont tangibles : elles retrouvent une stabilité, une autonomie et un rôle actif dans la vie collective.
Ces réussites sont le fruit d’un travail de terrain intense, porté par des femmes et des hommes engagés, souvent dans l’ombre. Elles montrent que la solidarité n’est pas un concept, mais une réalité concrète, ancrée dans les territoires. Et elles rappellent que, face aux crises, la réponse la plus durable reste celle qui part du terrain, s’appuie sur les ressources locales, et se construit dans la durée.
À LIRE AUSSI